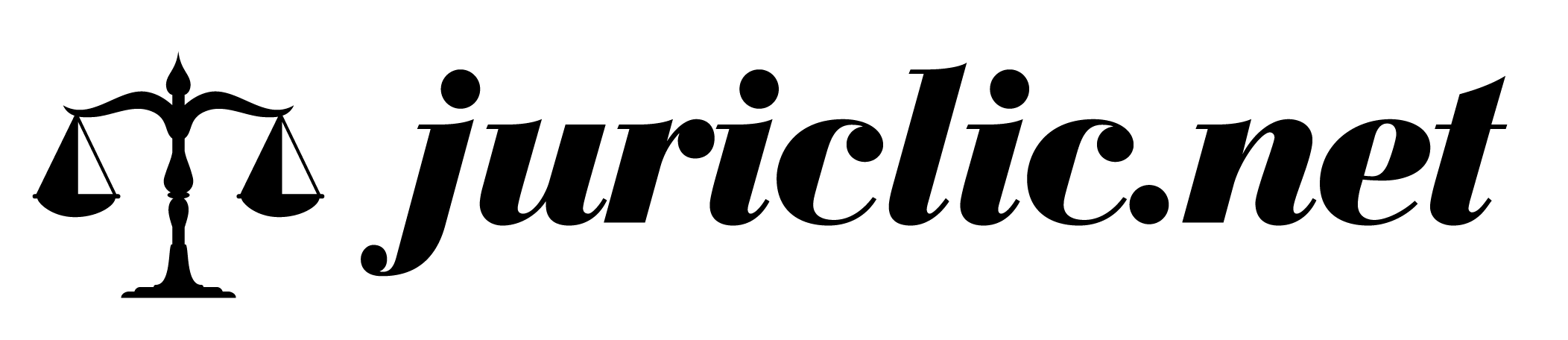Divorce et devoir conjugal : la France condamnée par la CEDH en 2025
Le droit du divorce en France connait de profonds bouleversements ces dernières années. Après la réforme de 2021 simplifiant les procédures amiables et le récent décret MARD de septembre 2025, une nouvelle évolution majeure vient de surgir : la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a condamné la France pour avoir prononcé un divorce sur le fondement du « devoir conjugal »....Read More
0
‘’Responsabilité du syndic : ce que dit le droit français’’
La gestion d’une copropriété en France repose en grande partie sur le syndic. Mandataire du syndicat des copropriétaires, il a pour mission d’assurer la gestion administrative, comptable et technique de l’immeuble. Mais que se passe-t-il lorsque le syndic commet une erreur ou néglige ses obligations ? Le droit français prévoit plusieurs formes de responsabilité qu’on va analyser...Read More
0

Réforme des régimes matrimoniaux : ce que change la loi du 31 mai 2024
Le choix peut être fait lors du mariage ou modifié au cours de celui-ci par une convention matrimoniale. Read More
0
Travaux dans une copropriété : quels droits et obligations des copropriétaires en 2025 ?
Les travaux en copropriété sont souvent une source de litiges : rénovations de parties communes, aménagements privatifs, isolation énergétique… En 2025, la législation et la jurisprudence rappellent l’importance de bien distinguer ce qui relève de la liberté individuelle du copropriétaire et ce qui nécessite l’accord de l’assemblée générale. Dans cet article, on fait le point sur les...Read More
0

Divorce amiable vs divorce contentieux : quelle procédure choisir en 2025 ?
Le divorce en France peut se dérouler selon deux grandes procédures : amiable ou contentieuse. Le choix entre ces deux voies dépend de la situation des époux, de leur niveau d’accord et de l’urgence des décisions à prendre. En 2025, avec les récentes réformes (décret MARD, médiation obligatoire), il est essentiel de comprendre les différences et les avantages de chaque...Read More
0

Médiation obligatoire dans le logement : comment résoudre un litige entre bailleur et locataire en 2025 ?
Les litiges entre bailleurs et locataires sont fréquents : loyers impayés, charges contestées, réparations non effectuées, dépôt de garantie non restitué…. Jusqu’à récemment, la plupart de ces conflits aboutissaient directement devant le juge. Depuis les réformes récentes en matière de Médiation et Modes Alternatifs de Règlement des Différends (MARD), la médiation devient une...Read More
0
Divorce en France : ce que change le décret MARD depuis septembre 2025
Depuis le 1er septembre 2025, une réforme importante est entrée en vigueur en matière de divorce en France. Le décret relatif aux Modes Amiables de Résolution des Différends (MARD) impose désormais de nouvelles règles pour les couples qui se séparent. Son objectif est clair : favoriser l’accord amiable et réduire les divorces conflictuels. Dans cet article, nous vous expliquons...Read More
0
Le droit des étrangers en France : les dernières réformes
réforme droit d’asile et immigration Le droit des étrangers en France a connu plusieurs évolutions récentes avec l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 ‘’pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration’’. Cette réforme touche plusieurs volets : titres de séjour, intégration, travail et contentieux administratif. Nouveautés sur les titres de séjour Création d’un...Read More
0
La médiation en droit du logement en France
réunion médiation La médiation est de plus en plus présente dans le traitement des litiges locatifs en France. En matière de droit du logement, elle offre une solution amiable, rapide et souvent moins coûteuse que la voie judiciaire. Elle concerne les conflits entre propriétaires, locataires, copropriétaires, voisins ou encore bailleurs sociaux. Qu’est-ce que la médiation...Read More
0
Jurisprudence récente en copropriété 2024 : 5 décisions clés à connaître
Avocat droit copropriété La copropriété est un terrain fertile en litiges, petits ou grands. Que vous soyez copropriétaire, syndic bénévole ou professionnel, il est essentiel de suivre l’évolution de la jurisprudence pour défendre vos droits ou éviter les faux pas. Voici une sélection de 5 décisions récentes de justice qui éclairent les problématiques fréquentes en copropriété. 1....Read More
0